Les Éditions Huit ont été fondées à Québec en 1990. Déjà en 1987, un premier titre, Travaux pratiques de Denis Vanier et Josée Yvon, avait paru aux Éditions Rémi Ferland, nées de manière imprévue et spontanée en réplique à la censure d’un organisme paragouvernemental pour lequel j’avais préparé la publication de cet ouvrage, mais qui se récusa pendant l’impression, en raison de photographies jugées transgressives. Ce coup d’essai me donna l’envie de poursuivre l’expérience, mais c’est seulement à la faveur de la rencontre de Louise Néron, qui deviendrait ma conjointe, que je bénéficiai de l’élan nécessaire pour amorcer à deux cette entreprise. Un soir d’été, nous devisions avec passion de ce projet à la taverne Bédard, rue Kirouac, et à la vue de la table de billard où un joueur venait de blouser la bille numéro 8 Louise proposa le nom de la maison à naître : les Éditions de la Huit. Dans la culture populaire américaine, cette bille, comme signe ludique du destin, est chargée d’une symbolique que nous augmentâmes encore à plaisir : le chiffre magique et infini de la nôtre serait tracé par la figure doublement lovée du serpent grec ouroboros, qui se dévore lui-même, autophagie exprimant le stade suprême de la connaissance. Nous étions lyriques et ésotériques, brûlants d’idéal, jeunes, en un mot… Mais cette foi est nécessaire pour transmuer le rêve en réalité.

Ancien logo avec le serpent
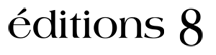
Logo actuel simplifié
Denis Vanier, le premier auteur que nous publiâmes, au printemps suivant, convenait en perfection à cet état de rébellion, de dénonciation, de revendication qui peut se résumer à la quête multiforme d’un surcroît d’existence. Comme il se doit, la couverture s’orna d’une photographie anticonformiste, un nu féminin, et, à l’avenant, tel un livre d’heures de notre communauté monastique, le texte s’enlumina de lettrines délétères et de filles damnées, œuvres de Louise. Je l’appelais tendrement « ma grande artiste ».
Cet état extatique n’empêchait pas d’agir de manière pourpensée et de tracer de droites perspectives. Dès le début, je m’assurai, dans mon activité nouvelle, d’une pleine autonomie par l’acquisition d’un équipement informatique complet, alors peu fréquent à la petite échelle qui était la mienne, celle d’un simple particulier. Entre autres, je me pourvus d’un digitaliseur, qui me permit de numériser les œuvres anciennes inédites ou épuisées que je comptais publier. Car d’emblée j’avais établi que tous nos livres se rangeraient en deux collections, les Contemporains et les Anciens, et notre programme de publication se développa en ce sens. Après la publication initiale ressortissant à la collection Contemporains en 1991, six titres parurent l’année suivante, dont un, Les Incas de Marmontel, ouvrait la seconde collection, celle des Anciens. Je m’enthousiasmais pour Chateaubriand et il me paraissait éminemment souhaitable de remettre en circulation cet archétype du cycle d’Atala. Les cinq autres publications de 1992 attestaient elles aussi ce parti pris de parcourir le continuum du temps, chacune en exprimant un de ses segments. La mort enterrée de David Cantin et Une Inca sauvage comme le feu de Denis Vanier, deux recueils de poèmes, marquaient ma volonté de rester sur la brèche, par la diffusion d’une littérature marginale, tandis que Quelques souvenirs de Jean Gagnon, libraire d’ancien à qui ma vocation bibliophilique doit beaucoup, participaient de cette résurgence du passé que je m’étais assignée comme mandat. L’éditeur est un procréateur : il crée à travers les autres. Cependant il se peut qu’il crée aussi par lui-même et mes deux publications personnelles de cette année-là s’inscrivent dans ce même regard qui explore le passé (Les Relations des jésuites : un art de la persuasion, un essai historique) ou cherche à comprendre l’immédiat (La table de cire, un roman sur le sort des livres, donc quelque peu métatextuel, écrit dans l’urgence et que j’appelle maintenant : « mon péché de jeunesse »). Si je fais de l’édition parce que, à la différence de bien de nos productions au long de la vie, scripta manent, en l’occurrence il me faut déplorer un peu cette immarcescibilité… Mais ne renions pas nos plaisirs, si vains qu’ils nous paraissent ensuite.
Oui, le plaisir surabondait et certains de mes livres parurent sur du papier de couleur, pour mon régal, comme si j’avais confectionné des pâtisseries. Hôtel Putama eut un tirage rose quartz, limité à cinquante exemplaires, numérotés et signés par l’auteur et les illustrations coloriées à l’acrylique. La mort enterrée s’afficha en gris perle, mon étude sur les jésuites en vert pomme.
En 1992 et 1993 naquirent respectivement Victor et Léa, nos deux enfants. Nous déménageâmes de la ville à la banlieue et notre mode de vie se mit au diapason de cet environnement disruptif. Ma carrière d’éditeur s’interrompit. Deux titres parurent néanmoins en 1994, Les dernières solitudes de Jean-Louis Tremblay, un recueil de nouvelles fleurant ma fragrance préférée, soit la nostalgie du Québec d’antan, et L’Amérindien dans les Relations du père Paul Lejeune, une autre étude sur la Nouvelle-France, par deux collègues d’enseignement et amis, Yvon Le Bras et Pierre Dostie. Ce dernier livre une fois imprimé, j’y remarquai aussitôt un doublon (quelques lignes répétées) dans la mise en pages. Le jour venu de passer à l’imprimerie, une dernière révision des épreuves s’imposait, qui m’aurait évité cette faute, mais une obligation familiale m’en empêcha. L’édition, surajoutée à la vie domestique et professionnelle, aurait exigé plus de temps. J’enseignais alors dix cours par année à l’université, de septembre à juillet, sans compter la correction des tests d’admission ainsi que diverses tâches administratives.
En 1996, les contingences de la vie quotidienne se firent plus clémentes. Dans l’intervalle, j’avais quand même maintenu mes recherches et au fil des trois années suivantes je proposai une série de sept éditions de romans québécois du XIXe siècle. Éditeur de Québec, j’entendais remettre à l’honneur les œuvres littéraires, au premier chef les romans, parues jadis dans cette ville et la production littéraire de l’École patriotique de Québec, active de 1860 à 1895 environ, devint mon corpus de prédilection. La valeur de ces textes, d’un point de vue tant littéraire, comme applications du romantisme français, que documentaire, comme témoins du passé, me séduisait et me fascinait. S’échelonnèrent ainsi, de 1996 à 1999, Pierre et Amélie de Édouard Duquet, Bataille d’âmes, L’affaire Sougraine et Le pèlerin de Sainte-Anne de Pamphile Le May, Nicolas Perrot de Georges Boucher de Boucherville, Sabre et scalpel de Napoléon Legendre et Une horrible aventure de Vinceslas-Eugène Dick. Dans tous les cas, il s’agissait d’éditions critiques : je trouvais important, afin que le lecteur puisse les comprendre et les apprécier pleinement, que ces œuvres reviennent au jour accompagnées chacune d’une introduction, de notes lexicographiques ou historiques, de documents d’époque et, le cas échéant, soit lorsque le manuscrit était disponible, d’un relevé des variantes. Ces publications attirèrent l’attention de certains collègues chercheurs en littérature québécoise et les deux années suivantes, en 2000 et 2001, trois d’entre eux me proposèrent des éditions analogues, adoptant le même protocole. Parurent ainsi, par les soins respectifs de Richard Ramsay, Jean Levasseur et Jean-Guy Hudon, Du Crapaud à cheval au Nain rouge de Marie Caroline Hamlin, La maison du coteau de Joseph Provost et La fille du brigand de Eugène L’Écuyer.
Ces collaborations furent à la fois agréables et profitables, la production d’un livre amenant ceux qui s’y impliquent à partager des considérations de tous ordres, par rapport tant à l’œuvre même dans son contenu qu’à sa présentation graphique. À ce sujet, il est singulier, mais en même temps révélateur de cette autre dimension relationnelle à laquelle le livre fait accéder, que le responsable d’un ces projets me restera à jamais, paradoxalement, à la fois inconnu et intime. En effet, nos échanges épistolaires et nos conversations téléphoniques furent suivis et nombreux, toujours cordiaux, mais, en dépit d’invitations réciproques réitérées, je ne rencontrai jamais Richard Ramsay. Il mourut en 2004. Je fus touché lorsque sa conjointe Brigitte Purkhardt me confia que j’étais son éditeur préféré.
De conserve avec l’édition des recherches de mes collègues, je poursuivais les miennes. En janvier 2000, à l’invitation de Jean Rioux, père de mon ami de toujours Jean-François Rioux, j’entrepris la publication d’un journal intime du XIXe siècle, celui de Jacques-Ferdinand Verret, fils du marchand général du village de Charlesbourg, en banlieue de Québec. Ce document manuscrit exceptionnel (dans tous les sens du mot, les journaux intimes de cette époque étant rarissimes) me fut confié par Michel Verret, petit-neveu de l’auteur, et je pus bénéficier en outre d’une première transcription produite par les soins de Jean Labrecque et Cécile Labrecque, de la Société historique de Charlesbourg. Ce projet d’édition captivant demanda cependant beaucoup plus de temps que prévu, en raison de la nécessité qui s’imposa de constituer, pour le profit du lecteur, un index des noms de personnes (plus de mille quatre cents) et des titres d’œuvres, en plus d’établir les cohortes familiales, incluant l’âge de chacun de ses membres. Ce n’est qu’en novembre 2002, soit près de deux après ses débuts, que cette édition parut.
La même année, la collection Contemporains, délaissée depuis 1996, reprit son activité. Je prenais en considération la recommandation d’un organisme subventionnaire, le Conseil des arts, et variais mon programme d’édition après douze titres successifs en six ans dans la collection des Anciens. Le second recueil de nouvelles de Jean-Louis Tremblay, La vie en vrac, fut suivie, en deux ans, de cinq autres titres d’auteurs contemporains: Le temps d’un roman du même auteur, Le réveil des dragons de Julie Lebrun, Triptyque de Gérard Bibeau, Un rôle inconnu de Côme Lachapelle et Les mots à découvert de Jean-Noël Pontbriand. Seul Un revenant de Rémi Tremblay, publiée par Jean Levasseur dans la collection Anciens en 2003, vint rompre cette uniformité.
Depuis 1997, les Éditions Huit faisaient partie du programme « Nouveaux éditeurs » du Conseil des arts. En augmentant et en diversifiant mon catalogue conformément à la suggestion de cet organisme, je devins admissible en 2004, par le nombre d’ouvrages parus et tous approuvés par les comités annuels d’évaluation, au statut d’éditeur permanent, qui me permettrait de bénéficier de subventions plus substantielles. Cependant, les Éditions Huit, à cette étape décisive, virent pour la première fois leur demande refusée et aucune subvention ne me fut accordée. Les éditeurs membres du jury ne souhaitaient sans doute pas accepter dans leurs rangs un autre membre qui diminuerait en proportion leurs prébendes, une hypothèse d’autant plus plausible que l’année précédente siégeait au comité d’évaluation la conjointe d’un éditeur concurrent, dont la maison, comme par coïncidence, reçut une forte subvention. Le fait est attesté par les rapports officiels conservés dans mes archives. Le Conseil des arts n’était pas, j’ose le croire, au courant de ce lien conjugal, aussi crus-je juste et nécessaire de l’en informer. Pour toute réponse, on me dit que les membres du comité étaient tenus de signer une déclaration relative aux conflits d’intérêts, signature qui suffisait à les placer au-dessus de tout soupçon.
Ce mécompte me décida à mettre fin aux activités des Éditions Huit. Néanmoins, je tenais à respecter les engagements contractés auprès des auteurs et fis paraître en 2005 trois titres, envisagés comme les derniers : Taches de naissance de Jean-Noël Pontbriand, Célestin Lavigueur de Magdeleine Bourget et L’imprimerie à Québec au XVIIIe siècle de Michel Brisebois. À ma surprise cependant, cette même année, le Conseil des arts, peut-être en prenant tardivement compte de ma lettre de doléances, m’accorda une subvention, mais assortie de conditions paradoxales : il fallait publier quatre nouveaux livres en un an et la somme accordée s’avérait insuffisante pour en publier deux. J’acceptai ce montant à la manière d’une « prime de départ ».
En 2006, je ne publiai rien. Dépourvu des ressources financières nécessaires, je dus même renoncer à la publication de Aux chevaliers du nœud coulant de Rémi Tremblay, alors pourtant que l’ouvrage était prêt à partir pour l’imprimerie, sa mise en pages et sa maquette de couverture complètement achevées. C’était une belle et imposante anthologie, totalisant 566 pages, de poèmes et de chansons, établie par Jean Levasseur. Je remis ce travail tout prêt aux Presses de l’Université Laval. Aujourd’hui, quand j’y pose un regard dans ma bibliothèque, mon impression ressemble à celle sans doute qu’éprouve un père à revoir son enfant confié en adoption et portant un nom autre que le sien.
Or, l’édition était ma passion et me priver de ses gratifications équivalait à rien de moins qu’à renoncer à la vie. Je choisis de continuer mon activité d’éditeur, mais à une échelle moindre et dans la seule perspective de mon plaisir. Le Conseil des arts demandait aux éditeurs subventionnés de publier annuellement un minimum de trois livres, chacun à un tirage d’au moins 500 exemplaires. Ces exigences, bien que certainement justifiées, pour ma part me pesaient. Je voulais prendre le temps de bien travailler et d’apprécier chaque étape de la production. Également, établir un tirage en proportion du lectorat potentiel me convenait mieux. En 2007 Les diaboliques de Barbey d’Aurevilly furent imprimés à 500 exemplaires, mais parce que cette édition pédagogique devait rester disponible pendant plusieurs années. Par contre, les titres qui suivirent de 2008 à 2013 furent habituellement limités à de petits tirages, variables entre 30 et 200 exemplaires.
Cette réorientation de ma maison d’édition s’accompagna aussi d’un changement de nom et de logo. Les Éditions de la Huit devinrent en 2006 les Éditions Huit et la bille ornée du serpent ouroboros disparut. Lecteur et bibliophile, je découvrais et collectionnais les belles éditions des œuvres de Paul Morand produites dans les années 1920 et 1930 par des éditeurs d’avant-garde et en particulier me plaisait celle de L’innocente à Paris par Simon Kra. La typographie élégante et aérée de sa page de titre inspira la nouvelle signature des Éditions Huit, considérablement épurée en regard des fontes gothiques appuyées qui l’exprimaient jusqu’alors. C’était non seulement une image différente, mais aussi une approche résolument artisanale et marginale de l’édition. Après avoir tenté en vain de me tailler une place dans une économie de marché, je revenais, rasséréné, au dilettantisme des débuts. Le critique Jean Basile m’avait écrit, le 7 mars 1989, à la suite de la publication des Travaux pratiques et alors que j’étais rédacteur d’un périodique dissident, N’importe quelle route, bulletin du club Jack Kérouac à Québec : « Restez petit, travaillez pour un cercle restreint, quelle bonne idée ! Vous avez tout à y gagner, sauf financièrement, je le crains. »
Disposant enfin de tout le temps requis, je publiai avec plus de soin encore qu’à mes débuts et, par conséquent, plus de satisfaction. Dans la collection Contemporains parurent Vous serez comme des dieux (un récit, en 2008) et Les voies de l’inspiration (un essai, en 2010) de Jean-Noël Pontbriand, Cet océan qui nous sépare (un roman, en 2008) de Réal Ouellet et La nation canadienne de langue française (un essai, en 2013) de Yvan Bédard. Ce dernier livre fut posthume. Yvan Bédard était un collègue et ami de mon père. Il avait été professeur en lettres anciennes et modernes, et auteur, entre autres, d’une étude sur Marcel Proust. Je l’estimais beaucoup. Cet essai, sorte de testament, il le termina avec ferveur et sachant sa fin proche. J’étais ému à la fois de respecter une de ses dernières volontés et de rendre hommage à sa mémoire.
La collection Anciens s’enrichit aussi parallèlement. Depuis 1996, je m’intéressais à l’œuvre de Vinceslas-Eugène Dick, feuilletoniste du XIXe siècle. En 1998, je commençai à prendre connaissance de son fonds d’archives, conservé au couvent des pères rédemptoristes de Sainte-Anne-de-Beaupré, et y retournai souvent les années suivantes, chaque fois pour un jour entier, afin d’étudier ses manuscrits. La première publication qui en résulta fut celle, l’année même de cette découverte, d’Une horrible aventure, suivie, étant enfin revenu à mes recherches, de L’enfant mystérieux en 2009 et de Le Roi des étudiants en 2010.
Signe de la plus grande liberté dont je jouissais comme éditeur, en 2008 je m’accordai la fantaisie d’une publication confidentielle à 30 exemplaires, celle d’un « carnet » intime, Le bœuf qui moud le grain.
À l’été 2007, je découvris Louis-Ferdinand Céline et en particulier ses fameux pamphlets, alors quasi introuvables et marqués du sceau de l’infamie qui les rendait plus intrigants encore. Dès janvier 2008, voyant que tout son œuvre deviendrait libre de droit ici quatre ans plus tard, je conçus le projet de rééditer ces textes, afin de combler ce qui me semblait une grave lacune dans la connaissance de l’auteur. Le corpus une fois saisi et mis en pages, j’entrepris la recherche nécessaire aux notes explicatives. Contrairement au XIXe siècle québécois, la période historique et littéraire à laquelle font référence les pamphlets ne m’était pas familière et j’avançais laborieusement. Durant un séjour à Paris à l’automne 2010, j’eus la chance inouïe de faire la connaissance d’un célinien émérite, Jean Castiglia, bouquiniste sur les quais, qui avait collaboré à l’édition de Céline dans la Bibliothèque de la Pléiade. Cette rencontre fut plus qu’une bonne fortune, plutôt une grâce, dans la mesure où l’amitié qui s’ensuivit se révéla pour moi providentielle. Jean Castiglia me mit en relation avec un spécialiste de Céline et professeur de littérature du XXe siècle à l’Université de Nantes, Régis Tettamanzi, qui avait publié une étude sur les pamphlets, Esthétique de l’outrance, sa thèse de doctorat, laquelle constituait, à proprement parler, l’appareil critique complet d’une édition critique encore à venir. Nous nous entendîmes tout de suite en perfection et cette collaboration marqua là aussi le début d’une amitié précieuse. Les Écrits polémiques de Louis-Ferdinand Céline parurent à l’automne de 2012 et connurent un succès considérable auquel, au vrai, je ne m’attendais pas. J’avais publié cet ouvrage à 400 exemplaires, estimant qu’il s’agissait d’un titre comme un autre dans la collection Anciens, mais dus bientôt procéder à des retirages successifs. L’aventure célinienne, à laquelle le parcours de ma maison d’édition ne me destinait pas, se poursuivit toujours imprévisiblement et quatre autres titres en lien avec cet auteur se sont ajoutés, soit, en 2016, une édition critique, derechef par les soins de Régis Tettamanzi, de la version manuscrite de Voyage au bout de la nuit et les actes d’un colloque relatif à ses pamphlets, puis, en 2018, une étude, Métro-tout-nerfs-rails-magiques de David Décarie, ainsi qu’une correspondance inédite, Lettres à Édith et à Colette.
Par ailleurs, en 2017 a paru le Dictionnaire des artisans du livre à Québec, commencé par Jean Gagnon et mené à terme par Jean Levasseur et moi-même, puis en 2020 Une traversée de l’Atlantique de mon regretté ami Claude Gas.
En 2018 a été fondée l’Association des amis des Éditions Huit, qui compte une centaine de membres, répartis dans une dizaine de pays. Un bulletin semi-annuel, Huis clos, tient les abonnés au courant des activités et publications des Éditions Huit.
* * *
Je remercie tous ceux qui me permettent de mener mon activité d’éditeur et contribuent à la rendre si enthousiasmante. Particulièrement, je nommerai, fidèles au fil du temps et qui ont publié chacun plus d’un livre, Jean Levasseur, Jean-Noël Pontbriand, Régis Tettamanzi et Jean-Louis Tremblay. Également, aucune des publications des Éditions Huit n’aurait existé sans mon ami Jean-René Caron, qui a conçu et assuré la présentation graphique de chacune, avec un talent et un soin remarquables, de même que son collègue Jacques Gosselin qui a réalisé le site Internet. Enfin, je rends hommage à mon père, Mario Ferland, qui m’a accompagné et soutenu depuis les débuts dans les diverses facettes de cette entreprise, tant pour la saisie des textes et les recherches en bibliothèque que pour les demandes de subventions et la révision des épreuves.
Rémi Ferland.